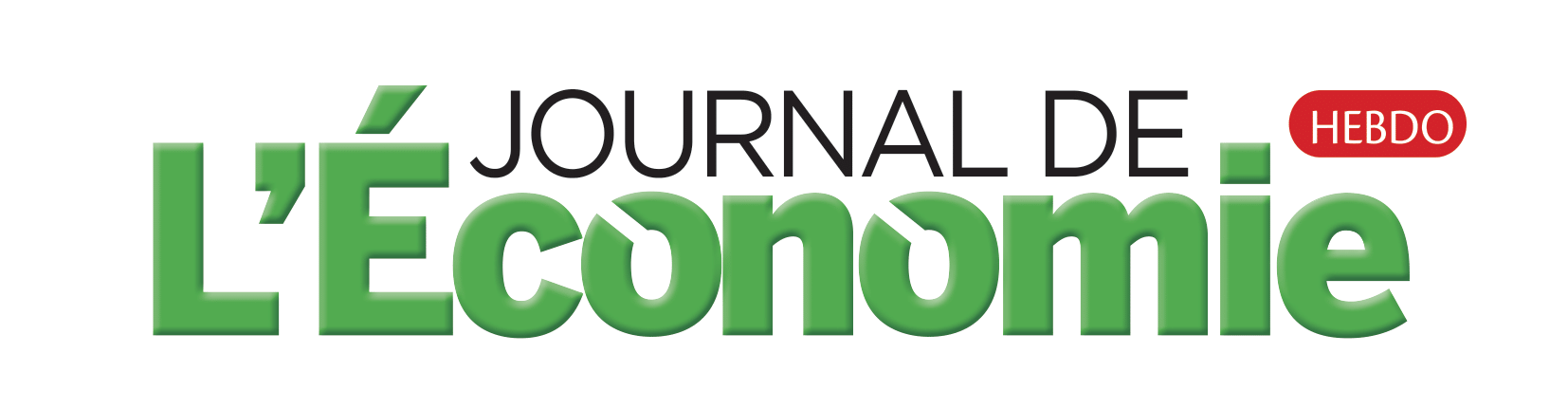La 8ème édition du Forum international de l’Afrique de l’ouest sur la finance islamique organisé à Dakar du 12 au 13 Juin a réuni les acteurs de la finance islamique. La rencontre dont le thème porte sur « les opportunités de financement islamique pour le secteur de l’énergie et la souveraineté alimentaire en Afrique de l’ouest » a été présidée par le Premier Ministre du Sénégal Amadou BA. Elle vise à promouvoir une stabilité financière dans la sous-région.
Sur initiative de l’Institut Africain de Finance Islamique, en collaboration avec le groupe de la Banque Islamique Développement(BID), le forum sur finance islamique s’inscrit dans le calendrier des conférences officielles du gouvernement du Sénégal. La finance islamique constitue un levier de développement économique des États à travers la mobilisation des ressources importantes des marchés financiers régionaux pour les projets de financement sociaux et d’infrastructures. « Il ne faut pas que notre région rate le train de la finance islamique surtout en termes d’investissements directs qui viennent des pays qui sont excédentaires en ressources de financement vers des pays qui en ont besoin. Je pense qu’il y a une adéquation avec le Plan Sénégal Émergent pour capturer ces investissements » a déclaré le PDG de l’Institut Africain de Finance Islamique, Mouhamadou Lamine Mbacké. La finance islamique a plus de 4 mille milliards de dollars et un taux de croissance à deux chiffres, une croissance exponentielle. Selon le Directeur National de la BCEAO au Sénégal, « une émission de SUKUK (titre financier islamique qui est l’équivalent d’une obligation dans la finance classique et respectant les préceptes religieux de la charia) d’un montant de plus de 1000 milliards de F CFA ont été réalisés dans L’UEMOA sur la période 2015 – 2022. Pour le Sénégal, il s’agit de trois émissions d’un montant de 600 milliards ( 100 milliards en 2014, 200 milliards en 2016 et 300 milliards en 2022) ». « C’est dans cette perspective que la BCEAO a entrepris des initiatives en vue de favoriser la promotion et le développement de la finance islamique » a fait savoir Ahmadou Al Aminou Lo. Parmi ces initiatives, figure l’introduction de textes réglementaires pour faciliter l’exercice de la finance islamique par les établissements de crédit et les institutions de microfinance dans l’Union au travers de tous les instruments standard compatibles avec les besoins de l’Union. L’activité financière Islamique est exercée actuellement dans l’Union Économique Monétaire Ouest Africain(UEMOA) par 18 institutions à savoir neuf banques et neuf institutions de microfinance. « En fin juin 2022, les actifs de la finance islamique sont évalués à environ 800 milliards de F CFA dont des dépôts d’environ 600 milliards de francs CFA. La répartition des financements fait ressortir que 33% ont été dirigés vers les services sociaux et les collectivités publiques, 19 % pour le commerce, la restauration et l’hôtellerie, 16% pour les bâtiments et travaux publics et 12% pour les industries extractives » a révélé. M. Lo. Pour sa part, Le Premier Ministre Amadou BA estime que « la majorité de la population de la sous-région est musulmane et que la finance islamique offre des solutions financières qui respectent les principes de la charia ». Ce qui permet selon lui aux musulmans de participer au système financier tout en respectant leurs croyances religieuses. D’après Amadou Ba, « La finance islamique offre des produits et des services adaptés aux besoins des populations non bancarisées, ce qui favorise leur inclusion dans le système financier formel et encourage les investissements éthiques et socialement responsables, notamment dans des secteurs plus durables et bénéfiques pour la société, tels que l’agriculture, les énergies« . Il ajoute que » les contrats utilisés dans la finance islamique, tels que le Mudaraba (partenariat) et le Musharaka (partenariat d’investissement), impliquent une répartition équitable des profits et des pertes. Ils contribuent à réduire les risques systémiques et à promouvoir la stabilité financière dans la
sous-région« .
Lansana Diandy